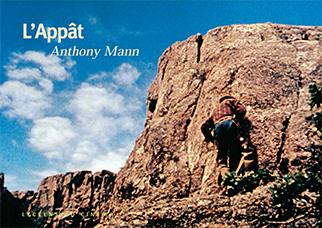Synopsis
Colorado, 1868 : Howard Kemp, paysan ruiné après la Guerre de Sécession par la femme qu’il aimait, poursuit, depuis Abilène, un truand, Ben, dont la tête vaut 5000 dollars et qui est accompagné par une jeune fille, Lina. Forcé de s’associer avec Jesse, un vieux prospecteur, et Roy, un ancien officier chassé de l‘armée, il parvient à capturer le bandit. La route sera longue vers Abilène pour le petit groupe : à l’hostilité du paysage et de ses habitants indiens, s’ajoute celle des protagonistes, Vandergroat, le hors-la-loi, ne cessant de dresser les hommes les uns contre les autres, aidé par Lina. Grâce à son sens tactique, il parvient d’ailleurs à s’enfuir, monnayant l’aide de Jesse avant de l’abattre. Choquée par ce meurtre, Lina fait échouer le piège que Ben tend aux deux hommes, le précipitant au fond d’un torrent. Voulant récupérer son corps, Roy se noie, mais Kemp réussit à se saisir du cadavre. Devant l’amour de la jeune femme qui se déclare enfin, il finit par l’enterrer, refusant de monnayer sa dépouille.
Distribution
L’appât est un film à cinq personnages (si l’on excepte les silhouettes indiennes qu’ils affrontent). Sans entrer dans le détail des analyses narratologiques, on peut les découper, dans leur mise en place, de la manière suivante : un sujet (Kemp), un objet (Vandergroat), des adjuvants (Roy, Jesse) pouvant devenir opposants (Jesse), une opposante pouvant devenir adjuvante(Lina), l’agencement de ces rôles pouvant se résumer ainsi : afin de toucher une prime lui permettant d’accéder à un bien matériel, un sujet doit conquérir un objet et, pour cela, est aidé et contré par d’autres forces actantielles. Bien évidemment, le récit ne se résoudra pas à cela, interrogeant justement la nature “ humaine ” de l’objet pour refuser de le voir envisagé comme un simple moyen (l’impératif kantien n’est pas loin). De ce fait, on s’aperçoit que ce qui est à conquérir n’est pas un avoir entaché d’une faute morale (la rentabilité d’un cadavre), mais un être consolidé par l’affirmation de son humanité (la promesse d’un couple).
Howard Kemp est le héros du film, son sujet principal au sens où c’est lui qui amène l’action principale à s’effectuer (sa traque de Ben commence bien avant le début de la fiction). En témoigne d’ailleurs le premier plan où il est centre et porteur du mouvement qui déterminera le film. Cavalier descendu de cheval, son revolver à la main, scrutant une mystérieuse fumée qui plane derrière les hautes herbes, il se caractérise par un geste physique, une parure reconnaissable et pragmatique (le revolver, l’éperon dont le gros plan ouvre le film (fidèle au titre original The naked Spur qui désigne l’éperon nu grâce auquel Howard aura raison de Ben, ainsi que le nom d’une montagne emblématique de la région où se déroule l’action), une connaissance immédiate du paysage naturel. C’est pourtant par rapport à ce dernier que la simple vision d’un Howard Kemp-machine westernienne (à la manière des personnages hawksiens) va évoluer : son itinéraire moral passera par deux bornes liées à la montagne au sommet de laquelle se tient Ben. Au départ, incapable de la gravir (il dégringole de manière assez peu héroîque), il y parviendra, à la fin, grâce à l’éperon, lui servant de crampon. Mais, entre-temps, il n’aura eu de cesse de tomber, de s’enfoncer plus avant dans la terre, en faisant l’expérience de sa précarité, de sa faillibilité, mais également de sa dimension humaine.
Cet apprentissage de la chute et de la douleur ira de pair avec la révélation de sentiments de plus en plus brûlants (les pleurs de Stewart représentent un cas assez rare de héros de western s’épanchant par les larmes) : en témoignent les scènes de la fièvre ou de la grotte dans lesquelles se lit une détresse qui éclatera à la fin. C’est que Kemp, au départ de l’aventure, est l’homme qui ruse (sa fausse identité de shérif, l’affiche pour la capture de Ben dont il a soigneusement dissimulé la somme offerte) pour conserver sa suprématie sur les autres. Sa place de pôle organisateur doit alors être éprouvée. Tous les plans où il se retrouve mis à mal par l’objectif, qui le dÈcouvre grimaçant, et suant, délirant ou peinant, voire ridicule et gauche participent de sa grandeur. Ils relient cette dernière à la reconnaissance de l’élément tellurien comme lieu de renaissance. La blessure à la jambe ou le dévoilement du passé malheureux lors de l’accès de fièvre ne sont que des excroissances de ce retour au sein d’une mortalité symbolisée par le double contact de la chair et de la terre bienfaitrices.
Il semble évident qu’une telle création fonctionne d’autant mieux qu’elle bénéficie du pouvoir de prévisibilité de l’acteur qui la porte : ainsi, Stewart n’arrive pas chez Mann nu et cru. La maniére qu’a l’objectif de saisir ses nombreuses chutes, en plongée et plan rapproché, consacre l’issue dramatique offerte à une image tressée par de nombreuses compositions. Après la guerre, Stewart, qui a mené, dans les années 30-40 une brillante carrière dans la comédie où il a créé une figure lunaire d’anti-héros gauche traversée de surprenants débordements d’énergie (voir The Shop around the corner de Lubitsch, 1936 ou Monsieur Smith au sÈnat de Capra, 1939), s’est retrouvé confronté à des univers beaucoup moins légers (western, thriller (Sueurs froides d’Hitchcock, 1958) ou polar (Appelez Nord 777 de Hathaway, 1947). De fait, le décalage d’un physique plus enclin aux déclarations d’amour échevelées qu’aux séances de lutte se comble grâce à une suractivité qui apparaît comme un moyen de dissimuler la fragilité de l’inadapté. C’est pourtant cette dernière qui, en ressurgissant sous la forme de handicaps physiques (la jambe immobilisée du héros de Fenêtre sur cour d’Hitchcock, 1954), de blessures physiques (comme dans le film qui nous préoccupe), voire morales (le mensonge sur lequel bâtit sa carrière le sénateur de L’homme qui tua Liberty Valance, 1962), le ramène à une humanité fébrile à l’innocence de plus en plus meurtrie. Ainsi, la vraie nature de Kemp n’éclate pas dans sa promptitude à saisir son colt tel qu’on le découvre en ce prologue : elle se tient plutôt dans sa manière d’écouter la mélopée des gouttes de pluie sur un orchestre d’écuelles. L’imagerie stewartienne qui n’a de cesse de se construire sur des déficiences partielles mais éloquentes est l’emblême primal du malaise dans le cinéma classique. En ce sens, l’étude du héros de L’appât est passionnante car elle met en échec tout a priori sur les stéréotypes du genre.
Ben Vandergroat
Si le rôle des angles est prépondérant pour Kemp, il l’est également pour Ben qui, au début en ombre et en contre-plongée, désigne un danger démiurgique associé au rocher duquel il envoie ses blocs de rocaille, comme autant de projectiles. Tout le long du film, le hors-la-loi sera cette menace croyant dominer le décor et les Ítres de sa supériorité. Mais, si l’on s’en tient au panthéisme de l’œuvre, on voit bien que, justement, son parcours sera inverse de celui de Kemp, la nature ne pouvant que maudire celui qui, loin de lui témoigner déférence en chutant à terre, ne cesse de se prétendre supérieur à ses valeurs. Littéralement, au final, le décor expulsera le bandit hors de son dôme, dans ce torrent bouillonnant qui est promesse de mort. Là encore, ce machiavélisme puni est renforcé par l’interprétation de Robert Ryan qui, à l’instar de James Mason ou de Georges Sanders, est un spécialiste des univers d’auteurs – Nicholas Ray, Fritz Lang, Jean Renoir, ou Max Ophuls-, ainsi que des rôles tourmentés de “ méchants ”. Créateur d’une figure souvent noire, aux éclats pervers ou simplement désaxés (rôle qu’il a déjà tenu dans le western, dans Le traître du Texas de Boetticher, 1952, par exemple), le comédien fait de son Vandergroat un Lucifer au petit pied, surtout dans ses rapports avec Lina qu’il croit posséder (voir les scènes de massage) et qui finira par être cause de sa perte.
Roy Anderson
L’officier dévoyé connaîtra la même issue que Ben et pour les mêmes raisons, parce qu’il croit dominer la nature et les hommes. Adjuvant fidèle mais dépourvu de moralité (on apprend qu’il a violé une Indienne et, lors de l’attaque, c’est lui qui inaugure le combat en abattant par surprise, le chef Cheyenne), Anderson possède une prestance nettement plus héroîque que Kemp : il gravit la montagne que ne parvient pas à escalader ce dernier, chevauche avec fougue et manifeste un cynisme et un panache assez constants. Ce côté séduisant (opposé à l’aspect pataud de Kemp) le mènera trop loin dans sa croyance en sa propre audace : la souche qui a raison de lui est un véritable rappel à l’ordre. L’interprétation de Ralph Meeker, jeune premier qui allait s’imposer en “ privé ” cynique dans le En quatrième vitesse d’Aldrich, 1954, est ainsi marquée par une impétuosité et une violence de force vive
Jesse Tate
Le vieux prospecteur raté est lui aussi condamné comme Ben et Roy à périr, d’abord parce qu’il trahit sa fonction d’adjuvant, ensuite parce qu’il ne cherche dans la terre que l’enrichissement matériel. Pour autant, Man ne le réduit pas une caricature : le pathétique qu’y met Millard Mitchell, connu pour ses seconds-rôles dans des westerns, comme La cible humaine de Henry King, 1950, ou des comédies musicales, tel Chantons sous la pluie de Stanley Donen – Gene Kelly, 1952, est celui d’un homme âgé, laissé-pour-compte de la Conquête de l’Ouest, qui pourrait poser une possible trajectoire virtuelle pour Kemp (comme lui, il est misérable et passe sa vie en vagabondant) si ce dernier ne rencontrait pas Lina. Mann adjoint souvent au personnage de Stewart un homme plus âgé comme vision possible de son avenir (le plus fameux étant celui campé par Walter Brennan dans Je suis un aventurier) : Tate en compose sans doute le versant le plus désespéré.
Lina Patch
La jeune femme, compagne de Ben, est typique d’une conception de la féminité dans le western, destinée à adoucir les hommes (elle sait masser, soigner et faire le café), à ouvrir leur brutalité minérale sur une dimension plus constructive, en même temps que pourvue d’un certain courage physique qui ne la fait pas démériter dans un univers viril. Les cheveux courts de Janet Leigh, alors jeune première imposée par la MGM qui n’avait pas encore joué dans Psychose d’Hitchcck, 1960, ni dans La soif du mal d’Orson Welles, 1957, sa moue juvénile comme ses manières de féline en font un personnage d’une rare densité physique, à la fois menaçante et apaisante, qui, en devenant l’adjuvante de Kemp après avoir été son opposante, lui permettra d’envisager des hypothèses d’avenir.
Générique
Titre original : The naked Spur
Réalisateur : Anthony Mann
Producteur : Willam H.Wright pour la Metro Goldwyn Mayer
Scénario : Sam Rolfe et Harold Jack Bloom
Chef-opérateur : Willam Mellor (Technicolor)
Direction artistique : Edwin B.Willis, Malcom Brown, Cedric Gibbons
Montage : George White
Musque : Bronislauw Kaper
Effets spéciaux : Waren Newcombe
Assistant-réalisateur : Howard C.Koch
Conseiller-couleur : Henri Jaffa, Robert Brower
Durée : 94 mn
Distribution : Metro Goldwyn Mayer
Interprétation :
Howard Kemp / James Stewart
Lina Patch / Janet Leigh
Ben Vandergroat / Robert Ryan
Roy Anderson / Ralph Meeer
Jesse Tate / Millard Mitchell
Autour du film
Les réactions provoquées par L’appât sont, dans leur globalité, typiques de l’attitude d’une critique qui, en 1953, n’ose pas avouer qu’un film de genre (traduire populaire, standard, voire commercial) puisse posséder les qualités d’un film dit d’auteur. Ces catégorisations que certains, dont Les Cahiers du cinéma, ont fort heureusement ébranlé, expliquent alors la timidité relative du relevé des qualités du film de Mann, y compris sous la plume de Rivette dans la revue de Doniol-Valcroze (Les Cahiers du cinéma n°29, décembre 1953). Pour ce dernier (symptomatiquement, le film est d’ailleurs traité dans la rubrique Les autres films), il est “ difficile ” de “ justifier ” “ l’affirmation ” de “ chef d’œuvres ” qu’il lui donne, surtout eu égard à la personnalité de Mann dont “les ambitions sont moins hautes que celles d’un Howard Hawks ou d’un Fritz Lang ”. Le point de vue de Rivette résume bien les autres, dans la mesure où il pose un jugement laudatif qu’il a quelque gêne à détailler : la simplicité élémentaire du western devient l’emblême d’un désarroi intellectuel qui peine à admettre l’émotion esthétique qu’elle enfante. Ainsi, on aime rappeler que si originalité il y a elle est “ relative ”, due à la connaissance des “ règles qui font les films d’aventures ” (Louis Chauvet dans Le Figaro du 9 octobre 1953), que ses beaux paysages n’ajoutent “ rien dont nous ne nous serions aisément passés ” (José Zendel, dans Les Lettres françaises du 8 octobre 1953), voire que son thème est “ né sans doute d’une usine de scénarios telles qu’il en existe dans chaque firme hollywoodienne ” (Jacques D’Heures, dans Radio cinéma du 18 octobre 1953). On relève, certes, ça et là, des qualités, mais on prend soin de les mettre en perspective d’un genre et d’un auteur rompus à ce type d’exercice. Le seul qui laisse véritablement dériver son enthousiasme est André Bazin qui, dans un article resté célèbre, Evolution du western, paru dans Les Cahiers du cinéma de décembre 1953, fait de l’appât “ le plus beau » des westerns de Mann, sans doute l’auteur des westerns les plus authentiques des ces dernières années. Attardons-nous rapidement sur le jugement de Bazin dans la mesure où il s’inscrit dans un “papier” plus vaste et prend place (comme toujours chez le grand critique) dans une approche théorique.
Si Mann est placé comme fer de lance, c’est parce que sa simplicité (de l’intrigue, du rapport individus-paysage) s’oppose à un tendance, désignée par l’auteur comme celle des “ surwesterns, westerns recouvrant un supplément intellectualisant pour se distinguer de la simplicité attachée au genre dont ils relèvent (il donne l’exemple du Train sifflera trois fois de Zinnemann, 1952) : avec son dépouillement qui le fait comparer à Bérénice, L’appât semble exprimer la quintessence d’un art primitif permettant au cinéma d’exalter ses valeurs premières, la saisie de l’évidence de l’être (on retrouve, bien évidemment, l’ontologie de Bazin et sa défense d’un cinéma où, par la grâce de l’objectif débarrassé de la main humaine, le monde éclate dans sa vérité).
Dans un certain sens, c’est ce classicisme (qui, dans ses fondements, concerne toujours l’union substantielle de l’homme et de l’univers) qui pose problème aux critiques (n’est-il pas trop simple ?) en même temps qu’il en séduit d’autres.
Etudier L’appât en 2004 manifeste, donc, la possibilit d’analyser par le texte cette catégorie mythique, autrement dit de vérifier les conditions d’un modèle (narration linéaire, représentation analogique) sur lequel on ne cesse de revenir. Comment fonctionne-t-il? Il est, avant tout, tentative de donner une apparence sensible à un itinéraire intérieur. Ainsi, si l’on doit retenir un schème fondamental du genre, c’est bien celui qui, délimitant un axe parallèle au plan de l’horizon, suggère un espace ouvert, dans lequel l’échange est possible ainsi que les nombreuses possibilités de rencontres, de transformations, qu’il informe. Avancer, c’est réduire les distances, favoriser le rapprochement : c’est donc, chez Mann, un mouvement qui est celui du lien naturel, social ou affectif. Mais arpenter ce chemin, c’est aussi s’en sacrer maître et, pour cela, combiner les diverses forces en présence en un principe qui est celui de l’appropriation.
Cette lecture symbolique est le fondement du film et de sa mise en scène, à savoir, la problématisation du western lui-même: l’Ouest n’est-il qu’un lieu à conquérir? N’existe-t-il que par les possibilités qu’il offre aux personnages d’y tracer un monde à leurs dimensions? La transcription de cette douloureuse question prend la forme d’un segment de droite en perpétuel mouvement vers l’avant, qui resitue l’insert initial sur l’éperon dans sa fonction expansionniste : le rêve de Kemp, rebâtir son ranch, n’est qu’un prolongement de la préalable invasion du champ que scandent les premières images.
Face à ce désir, le territoire n’est pas photogramme amorphe : il participe de la grandeur du héros en intimant les étapes de l’itinéraire qui le mènera à accomplir son programme, à savoir sa propre domestication, légitimée au nom d’une grandeur morale qui interdit à l’homme injuste de le prendre. Le rôle de la mise en scène est alors de transformer une géographie extrêmement diversifiée en un espace filmique homogène. La manière la plus évidente par laquelle il s’imprime tient dans les plans récurrents, généralement d’ensemble ou de demi-ensemble, au sein desquels les protagonistes chevauchent. Ces images expriment la respiration interne du genre, en même temps qu’elles objectivent le parcours du héros, le conjoignant à une promesse de redéploiement, en place d’une certitude de repliement.
Un autre archétype, dans L’appât, bénéficie d’un traitement analogue : il s’agit du duel.
Lorsque Ben se relève face à Howard, inquiet, lorsque ce dernier, après la tentative d’évasion, veut l’abattre, lorsqu’il se tient face à la petite troupe qui, en cet, instant, lui manifeste son hostilité, ou au chef Indien, chacun des protagonistes dessine, par son positionnement, ou le travail du montage qui fait correspondre les plans des adversaires entre eux, cette figure où, coordonnés par rapport à un invisible axe de symétrie, s’ébauche l’affrontement régulier en ses prémices. On insistera donc sur ce motif, virtuel ou actualisé, dans la mesure où il trace la mauvaise conscience du genre en même temps que le fondement de ses mutations maniéristes (les lents affrontements détaillés des westerns Italiens de Sergio Leone) ou révisionnistes (les massacres perpétrés au nom du droit de Little big Man d’Arthur Penn, 1970).
En effet, ce rappel d’une géométrie symbolique est la marque virtuelle de la destruction programmée du territoire naturel. Le duel condense l’espace métaphorique de la destruction en un segment de droite implicitement tracé entre deux adversaires : ce qu’il suggère, c’est que la distance à parcourir n’est que celle qui sépare un homme et son but, ce dernier comprenant dans son parcours l’éradication de l’élément malfaisant proposé comme épreuve. Quand se déploie ainsi cet axe, l’échange horizontal redevient celui d’une conquête permanente, l’espace n’étant déployé que pour être approprié par celui qui aura raison de l’autre. L’évidence du classicisme n’exclue donc pas la lucidité de l’interrogation : c’est par le sang versé que l’on avance et si l’on s’en tient au plan où Stewart contemple, en profondeur de champ, les Cheyennes massacrés, on voit bien que Mann fait sienne l’idée d’une conquête bâtie sur des charniers. Le motif du duel (qui n’en est que la représentation sublimée et ritualisée d’un tel schème) hante ainsi L’appât, mais jamais sous une forme pure. En n’en gardant que l’esquisse, Mann maintient l’idÈe d’un paysage vierge, où le travail de l’homme n’est qu’un devenir. C’est sa manière à lui de laisser la suprématie à la nature, ou, plus exactement, de conférer à cette dernière, le pouvoir de bénir l’action humaine, en s’en faisant l’adjuvant. De fait, la victoire morale finale d’Howard ne peut être donnée que par l’encadrement du beau visage de Lina par le ciel bleu, ciel qui réapparaîtra avec ses nuages surplombant les monts neigeux en un panoramique le reliant à l’action d’enterrer Ben.
L’élémentaire participe de la victoire humaine : c’est sans doute cela qui donne son poids classique à L’appât et en fait une leçon de mise en scène : pas de distance ricanante envers ses personnages, ni de citations complices à l’égard du spectateur. Simplement des êtres humains se cherchant au milieu de la rocaille : c’est tout et cela suffit.
Pistes de travail
- L’appât a-t-il un lien avec le cinéma d’action actuel ?
La question peut sembler provocante, mais elle veut effectuer un pont possible entre le film de Mann (appartenant à un genre qui, comme nous l’avons dit, n’existe plus guère aujourd’hui) et des films d’action plus récents. Ainsi, des duels acrobatiques de la série des Matrix de Larry et Andy Wachowski, 2000-2003, aux batailles rangées des polars de John Woo (Volte-face 1999), des œuvres continuent de développer les archétypes de L’appât, en les recyclant dans d’autres univers. Et, pour cause : au-delà du western , c’est la reprise d’une image unique, souffrant de multiples variations, celle de deux êtres marchant l’un vers l’autre pour s’affronter, qui leur sert de point commun. Si l’œuvre mannienne peut sembler être un modèle, c’est qu’elle place les motifs et les issues de ce schéma comme relevant de la morale. L’époque actuelle tend à décupler, bien évidemment, les proportions des affrontements, et à styliser le plus possible ces derniers (voir les magnifiques Kill Bill 1 et 2 de Tarantino) suivant une perspective maniériste plus affirmée, puisant du côté du cinéma asiatique (japonais ou honk-kongais). Cette perspective va de pair pour certains avec la complexité d’intrigues qui mettent en doute la réalité diégétique des univers qu’ils traversent, en pointant du doigt clonage, robotisation ou virtualité comme les nouveaux dangers (la série des Matrix au premier chef). Face à eux, le film de Mann appartient à une époque où les obstacles se découpent à même le décor, sans effet spécial, ni travestissement. De fait, c’est dans sa simplicité et sa volonté objectivante (les décors et les actions rendant efficientes les passions des héros avec le plus de réalisme possible) que L’appât peut prétendre, aisément, à un statut de “ patron ”. - Auteur et genre sont-ils des termes irréconciliables ?
Il faut préciser, avant le moindre débat, que l’une comme l’autre de ces notions ne sont que des constructions théoriques du spectateur : c’est sur la base de textes filmiques que l’on bâtit les figures, respectivement collective et individuelle, du genre et de l’auteur. Il faut alors réfléchir en termes d’échanges : les cadres du genre sont (à la base) virtuellement composés en repérant et dégageant les points communs thématiques et formels de plusieurs productions signées par des auteurs. La singularité de ces derniers se mesure essentiellement par la manière dont ils élargissent les limites au sein desquelles ils travaillent (on ne peut plus penser le western de la même manière depuis Sam Peckinpah, comme on ne peut plus voir de films de guerre sans avoir Apocalypse now en point de référence). En retour, le genre y gagne son existence qui ne saurait être qu’historique, donc en mouvement.
Application avec L’appât : le plan où Stewart tue à coups de crosse un indien est inscrit dans une perspective qui est celle du western (cadre naturel de l’Ouest américain, costumes et typage ethnique des protagonistes correspondant à des modèles culturels connus), mais le cadrage rapproché sur un affrontement qui n’a rien d’héroîque, allié à la longueur du plan, met en avant le côté laborieux et sauvage de la mort de l’adversaire (qui ne serait pas filmée de la même manière par Walsh ou Ford). Cette sèche austérité qui renvoie la violence à une épure terrifiante se retrouve dans L’homme de la plaine (la main meurtrie de Stewart), dans L’homme de l’Ouest (la mort du vieux Lee J.Cobb par Cooper) ou dans Winchester 73 (le cadavre sur lequel on tire encore) : elle est une marque d’auteur. Par là même, elle nuance certains éléments définitoires du western (notamment son soi-disant manichéisme) et contribue à complexifier sa définition. - Comment L’appât manifeste-t-il son inclusion dans le genre ?
Le genre a quelque chose d’un rituel, dans la mesure où il réitère, au gré de ses productions, un certain nombre de paramètres récurrents dont la reconnaissance entraîne chez ses fidèles un phénomène collectif d’appartenance à une communauté idéale (les amateurs du genre…) qui se retrouve au gré des mêmes instants unificateurs. L’appât possède ainsi un prégénérique particulièrement éloquent qui ne lasse planer aucun doute quant à son appartenance.
Soit le plan d’ensemble très composé d’un paysage où, du tronc de bouleau, au premier-plan, jusqu’au mont, en profondeur, en passant par la prairie, le ruisseau, et la forêt, apparaissent les diverses composantes végétales et minérales qui constitueront le site global du film. Ce paysage est déjà un clin d’oeil envers le public, un signe quant à la nature de l’aventure à ciel ouvert qu’on va lui narrer. Ces éléments ainsi disposés, la caméra choisit, en un brutal panoramique, de remonter en amont et de se concentrer sur l’éperon d’un cavalier. Au-delà de l’importance narrative du détail (c’est grâce à lui que Kemp aura raison de Vandergroat), au-delà du rappel de la puissance démiurgique du metteur en scène (en un effet de focalisation externe particulièrement puissant), c’est le signe vestimentaire d’une parure, celle du cavalier, qui nous est donné. De fait, en replaçant l’emblématique tige de métal dans son contexte, celui du costume d’un homme, l’objectif confère à ce dernier un privilège, celui d’être le centre du champ, puisqu’il occupe le vide du décor initial en s’éloignant vers les cimes. En quelques recadrages, la vignette de départ – même axe, même étagement -, s’est métamorphosée grâce au porteur de l’énigmatique ergot : un être chevauche dans un paysage apparemment vierge tandis qu’un générique, dont les lettres ont un caractère “ Playbill ” s’énonce sur une musique dramatique : nous sommes bien dans un western .Que cette entrÈe en matière génère des questions (à qui est cet éperon ? D’où vient ce cavalier ?) ne doit pas faire oublier qu’elle répond à la première d’entre elles : dans quel univers nous introduit-on ? - Quelle représentation de l’héroîsme donne L’appât ?
Le héros, c’est-à-dire l’homme qui se distingue des autres par une aptitude particulière, est le centre du western, et son évolution un vecteur essentiel pour la compréhension des mutations du genre. Il peut être intéressant de relever et d’étudier ce qui, dans L’appât consacre Kemp héros. Il est d’abord l’embrayeur du récit et, en ce sens, sa position centrale, telle qu’on la détermine dès les premiers plans, atteste qu’il se place comme le personnage principal. Mais, pour ce qui est des attributs héroîques ordinaires, à savoir l’alliage de l’infaillibilité technique et du courage, on n’en trouve peu d’échos : moins bon grimpeur que Roy, moins séduisant que Ben, voire moins connaisseur de terrain que Jesse, Kemp compense, dans un premier temps, ses handicaps par la ruse et une méfiance de tous les instants. Sa seule singularité, en terme d’épreuves, demeure, comme nous l’avons dit, son incroyable propension à supporter les blessures, physiques d’abord (sa cuisse, ses dégringolades multiples), morales ensuite (son passé douloureux, la scène dans la grotte où il est trahi par Lina), et à continuer, malgré cela, à avancer. Cette tendance se trouve particulièrement mise en avant par le jeu de Stewart qui n’hésite jamais à laisser percevoir ses sentiments. Par le fait, ces épisodes lui font gagner sa place d’homme et, donc, sa légitimité à espérer réintégrer le vieux rêve agrarien qui baigne tout cavalier solitaire : le ranch. C’est parce qu’il aprend à trouver sa place au sein du paysage que Kemp eut prétendre à un statut de héros. - L’appât est-il un film panthéiste ?
La question peut sembler incongrue, mais elle se veut engager un des traits des westerns de Mann, à savoir la participation des éléments naturels à l’établissement d’une morale. Ces éléments sont donnés comme simplement évidents : il sont et cela renforce le caractère substantiel des valeurs qu’ils aident à éclore. Ainsi, si la montagne rejette littéralement Kemp au début (et son ascension est filmée en une contre-plongée qui accentue la dérisoire de son effort) pour l’accepter à la fin (et là c’est latéralement qu’il est saisi), c’est bien parce que ce n’est pas le même homme qui la gravit, et qu’au terme de l’aventure, son humilité lui a appris à retrouver sa vraie place au sein du décor.
Pareillement, le rôle de l’eau finale s’inscrit dans une dialectique qui la sacre détentrice des jugements ultimes : filmée comme le lieu de la chute ultime, celui où tout peut s’engloutir ou renaître, elle est un cercueil pour Ben et Roy, et une consécration définitive pour Howard : c’est à l’issue de son passage qu’il pourra librement décider de ne pas monnayer un cadavre et de réemprunter la trajectoire horizontale, en un dernier plan riche en hypothèses.
On pourra alors s’interroger sur la façon dont la paysage, loin d’être une carte postale exotique, exprime, en les rendant apparentes, les règles du devoir-être dont il est le garant : témoin aussi le dernier panoramique du film qui réunit le ciel, les nuages et les deux protagonistes qui, après avoir rendus Ben à la terre, s’en vont. C’est lorsque l’homme s’est admis comme issu de la terre, que la voûte céleste peut enfin le bénir. - Quelle est la valeur des mouvements de caméra dans L’appât ?
On sait que, par ce terme, on désigne ce qui confère sa singularité au plan cinématographique, le fait qu’il soit, en sus d’être spatial et temporel, une unité de mouvement. L’appât utilise principalement deux types de mouvements de caméra : les panoramiques (ou la caméra, posée sur un pied, pivote sur son axe sans bouger, en un mouvement qu’on pourrai qualifier de balayage) servent ainsi à lier le paysage et l’homme en une relation forte qui a tout d’une inclusion. Ainsi, lorsque l’objectif quitte le plan large de la troupe pour glisser sur la prairie et la forêt avant de s’arrêter sur le plan américain d’un Amérindien aux aguets, c’est toute la signification du rôle de ce dernier, comme niché dans les profondeurs du paysage originel, qui est établie. C’est également la transcription physique de son appartenance à la même nature que celle des monts et des vallées. Pareillement, quand de l’étendue on passe à l’éperon qui l’habite (le premier plan du film), ou que, des montagnes on descend vers le couple les quittant pour la Californie (le dernier que nous avons déjà évoqué), la participation élémentaire des héros y acquiert une fluidité immédiate. Ici, le rôle de cette figure est de révéler que le lieu est toujours susceptible d’élargissement, et que c‘est par la pratique de ce dernier qu’il devient un espace. Dans le même souci, le travelling (ou la caméra posée sur un support en mouvement -rail, véhicule ou corps humain- qui se déplace) d’accompagnement (désigne le travelling accompagnant à la même distance un élément en train d’évoluer) qui, ici, à plusieurs reprises, décrit, avec empathie, les instants de pur itinéraire, fait de la caméra, l’ombre du personnage en exercice, Mann cherchant à épouser physiquement son inscription dans le paysage, afin de la décrire comme une dynamique sans cesse redéployée dont on ressentirait l’urgence. Là, il s’agit de donner à éprouver au spectateur cette sensation physique (le déplacement) qui est le fondement du genre (aller vers l’Ouest, c’est aller de l’avant). Dans un cas comme dans l‘autre, c’est en tant que totalité ouverte et dynamique que se conçoivent le paysage et ses valeurs - Comment sont représentés les Amérindiens ?
La question est importante, surtout pour un public actuel qui n’ignore plus la réalité historique du génocide amérindien aux fondements des Etats-Unis. Rappelons tout d’abord qu’il s’agit de représentation et donc d’une manière de voir et de montrer filtrée par des codes et, qui plus est, toujours dépendante de “ blancs ” (à quelques rares exceptions (dont le <>Phoenix Arizona< /b> de Chris Eyre), les responsables de l’imagerie des Amérindiens au cinéma ne sont pas issus de leurs cultures). L’appât manifeste un point de vue critique sur cette figure qui a bénéficié de représentations souvent ambivalentes, entre l’ivraie humaine juste bonne à être éradiquée surgissant au milieu des broussailles ou en haut de la crête (par ex La charge fantastique (They died with their boots on)de Raoul Walsh, 1941), le bon sauvage porteur des saines valeurs perdues de la nature qui essuie la trahison des blancs et la félonie des siens (La flèche brisée (Broken arrow) de Delmer Daves, 1949) et le symbole de la mauvaise conscience d’un peuple filmé comme une minorité ethnique assassinée (Danse avec les loups (Dancies with the wolves) de Kevin Costner, 1991). Globalement, le Cheyenne ou l’Apache, pères primitifs, tissent un pôle ambigü pour les Américains, à la fois garant de leur enracinement naturel et de la légitimité au nom de laquelle ils l’ont détruit. Ce thËme majeur qui problématise le genre (comment se justifier de la pureté d’un paysage si cette dernière se détermine par le sang ?), est traité, ici, en quelques plans révélateurs d’une culpabilité prononcée, la brutalité des Amérindiens, tant mise en avant par les thuriféraires de leur génocide, devenant l’apanage des héros “ blancs ” : le plan de Stewart tuant à coup de crosses le guerrier, celui où Jesse en abat un dans le dos, celui qui consacre, en profondeur de champ, la vision du charnier contemplé par un Stewart amer, résument un doute majeur quant à la supériorité éthique du Blanc. Qui plus est, l’œuvre assimile (notamment dans leur présentation) cheyennes et cadre naturel, ce qui tendrait à faire de l’Indien, au même titre que le torrent ou la grotte, un élément, certes ambivalent, mais sacralisé (on se rappelle que Mann est l’auteur d’un des plus beaux westerns pro-indien, La porte du diable avec Robert Taylor). - L’appât est-il un “ film d’hommes ” ?
La question renvoie à la représentation de la femme dans L’appât pour constater que, comme dans bon nombre de westerns, elle est ambivalente : on s’en voudrait de revenir sur le paradigme institutrice-chanteuse de saloon, aux yeux de certains, fondamental pour la compréhension de l’élément féminin dans le Far West écranique, mais il possède ici quelque vigueur.
Qu’est-ce qu’en effet que Mary, l’ex-compagne de Kemp qu’il appelle, fiévreux, sinon une ombre traîtresse qui a précipité le héros dans le malheur ? Lina, lorsqu’elle séduit Howard pour permettre à Ben de tenter de s’évader, recouvre partiellement ce rôle qui la place du côté des dangers possibles. Mais à la limiter à cette vision périlleuse, on en resterait à une mythologie misogyne de mauvais aloi : la femme est aussi celle qui porte les valeurs de l’Eros dans un univers largement dominé par le Thanatos. Cela lui permet d’apaiser les douleurs des hommes, et, surtout, de les aider à ouvrir leurs perspectives sur de meilleurs horizons (le beau visage de Janet Leigh cadré sur fond de ciel bleu l’identifie à un motif de pureté qui renvoie, soudainement, à un plan fordien). Alors, oui, d’un certaine manière, L’appât est un film d’hommes dans la mesure où, entre la tentatrice redoutable et la compagne fidèle, Lina est tributaire d’un regard qui fait de la cavité intra-utérine dont elle est l’incarnation le lieu des regénerescences comme celui des étouffements. - L’appât est-il un récit homéostatique ?
Les études narratologiques nous apprennent que le récit classique est un discours essentiellement conservateur qui tend à mettre en péril un équilibre pour le mieux consolider au final, ou, autrement dit, qu’il rétablit l’équilibre qu’il a ébranlé en son point de départ. C’est, en effet, ce que nous disent les dernières images de L’appât : Kemp y retrouve l’union femme-promesse de foyer rural qui lui a été jadis ôtée. Pour autant, ce final ne dessine que des perspectives matériellement incertaines (elles se cristallisent sur le départ du couple), alors que ses prémisses, telles qu’on les déduit de la plaie initiale – la trahison de Mary -, propose des certitudes : un ranch quantifiable et localisable sur lequel règne la fiancée. Il n y a donc pas équivalence véritable entre les deux bornes, simplement le passage entre ce qui est reconquis et ce qui se pose comme fondement, une mesure à estimer pour tirer la dimension argumentative qui sous-entend son tracé. Le conservatisme d’un récit n’est jamais qu’apparence, car l’écart entre la fin et le début change fondamentalement le retour du même. C’est la somme de toutes les épreuves traversées par le héros qui transforment cette donne initiale : ainsi, ici, les diverses séquences narratives qui mettent en place l’itinéraire de Kemp (voir Quelle représentation de l’héroîsme donne L’appât ? ) sont théoriquement destinées à montrer la capacité du sujet à être digne de relever le défi préalable que pose le rachat de son ranch : ce n’est que parce que ces dernières révèlent son humanité et sa fragilité, comme contre-poids à sa vénalité et déloyauté préalables, que Kemp se verra offrir cet horizon virtuel, bien plus galvanisant que celui qui lui a été ravi. En se débarrassant de toute aptitude au calcul et à la ruse, Howard refuse d’emprunter le même chemin qui a causé la perte de son paradis (c’est par intérêt que Mary a vendu sa propriété) et le récit se bouclera sur l’idée d’un recommencement libéré des souillures de l’origine, ce qui, pour un film s’inscrivant dans une Geste prenant appui sur l’idée de la renaissance du Monde (les Etats-Unis comme éclosion d’un univers par tous ceux qui ont assisté à la faillite de leur propre macrocosme), est somme toute assez exemplaire. - Quelle est la représentation de la violence ?
On remarque souvent, et à bon droit, combien la violence occupe chez Mann une place prépondérante : par ailleurs, cette question qui revient périodiquement hanter les questions de la pédagogie de l’image (voir le rapport de Blandine Kriegel) est toujours intéressante à aborder par l’analyse directe et non sur de simples “ a priori” . La violence de L’appât est une violence spontanée, soudaine, appartenant au Milieu comme une donne incompressible : nous sommes loin ici de la ritualisation de la brutalité que peuvent constituer les duels léoniens (pour prendre un exemple “ moderne ”) ou les batailles walshiennes (pour rester dans le domaine classique). A l’image des rochers qui surgissent au début du film et manquent d’ensevelir Kemp et Tate, la violence jaillit du paysage comme une de ses composantes.
On étudiera dans ce sens aussi bien la maniËre dont Ben est abattu (loin de tout canon de loyauté), la fulgurance de l’éperon se fichant dans la joue auxquels font écho les deux coups de feu de Roy, la façon dont Kemp massacre l’Indien à coups de crosses, la brève lutte Kemp-Anderson, pleine de poussière et de laborieuses empoignades, que la force de la souche qui vient écraser et emporter Roy dans le torrent. C’est lors de ces instants-là d’ailleurs (et durant toute la dernière scène autour du cadavre de Ben) que l’on peut mesurer qu’un des apports fondamentaux de Mann consiste dans le traitement de la bande-son. Refusant la dramatisation musicale, de mise dans ce type d’épisodes, le cinéaste laisse les bruits naturels (celui de l’eau qui gronde, des chevaux qui cabrent, ou des combattants qui s’essoufflent) recouvrir son action, comme pour mieux donner à voir la violence dans son déroulement atrocement banalisé, ainsi que dans son rapport crucial avec un environnement dont il n’est qu’un mode d’expression.Fiche mise à jour le 15 septembre 2004Fiche réalisée par Philippe Ortoli
Expériences
Film de genre, et même film d’un genre passablement oublié aujourd’hui pour cause de raréfaction sur les écrans, L’appât ne peut être, ainsi, envisagé hors du cadre westernien. Ancré dans l’histoire d’un pays, ce dernier a atteint l’autonomie de sa dénomination substantive avec le cinéma et ce, dans les années 20 : auparavant, associé à d’autres termes catégoriels (melodrama, comedy), c’est donc avec le Septième Art que le western advient sémantiquement. Désignant une œuvre mettant en scène des situations et des personnages issus de la Conquète de l’Ouest américain, (définition souple lui permettant d’accepter des films se situant au Mexique, à partir du moment où ses protagonistes proviennent des Etats -Unis originels – du type La horde sauvage (The Wild Bunch)de Sam Peckinpah, 1969 -, et d’y faire entrer des métrages se déroulant à une époque plus contemporaine mais où se manifestent des éléments connotant les représentations de cette période et géographie-clés- par exemple Les désaxés (The Misfits de John Huston, 1961 -), il est indissociable de la mentalité propre à la collectivité donnée dans laquelle il est né.
Ainsi, lorsqu’on lit les travaux de ceux qui ont cherché à postuler l’identité américaine à travers ses diverses représentations (littéraires, théâtrales, journalistiques, politiques), un thème émerge entre tous, celui de la Frontière.
Sa théorie, due à Frederick Jackson Turner, historien emblématique (1831-1932), postule que cette civilisation s’est bâtie suivant un schéma directeur, l’avancée vers des terres vierges dont la frontière est sans cesse repoussée. Cette permanente relance du défi de la construction autorise l’expansion à être continue. C’est grâce à cette vision que l’on peut comprendre la signification du West fondateur du terme western : il désigne beaucoup moins la direction géographique de la conquête qu’une trajectoire mythique (celle de l’avancée vers le point où le soleil se couche, borne que l’on n’atteint jamais et qui guide de sa lumière lointaine les destinées des nomades). En ce sens, le western témoigne que la mythologie américaine est essentiellement une mythologie de l’horizontalité, faisant de la conquète sa figure de proue, en repoussant sans cesse le moment de son arrêt.
Les désirs des personnages de L’appât sont ainsi bercés par l’assurance physiquement estimable du renouvellement permanent que prodiguent les vertus de ce légendaire point cardinal.
Ce cadre global ayant été posé, il convient de rentrer plus dans les détails du contexte direct du film. L’appât est donc le cinquième western de Mann sur 11 et le troisième du cycle qu’il créa autour de la figure actorielle de James Sewart. Compte-tenu que le dispositif “ Enseignements obligatoires ” propose une autre œuvre participant de cette série (), il peut être intéressant de réfléchir à la question de l’unité de ces cinq films. Contrairement à Ford, Mann se garde de toute tradition épique : chez lui, la référence à la mythologie westernienne via ses personnages (historiques (Wyatt Earp dans Winchester 73) ou inventés (le Baron du bétail joué par Donald Crisp dans L’homme de la plaine condense la figure des empereurs des prairies qui, tels Chisum ou Tunstall, incarnent la sève originaire du capitaliste américain)), et ses situations (la marche des pionniers dans Les affameurs, la guerre de Sécession dans L’appât, fort-Laramie dans l’homme de la plaine), est un bas-relief sur lequel se détachent les véritables motifs de ces films. L’intimisme qui se dégage de ces œuvres (et dont L’appât est la plus belle illustration) en revêt une vocation allégorique : en mineur, avec leurs sentiments et leurs peurs, les protagonistes rejouent, dans un souci d’épure exacerbé, les archétypes fondateurs de la Geste. L’art mannien, celui qui le fait consacrer dans les histoires du cinéma comme un cinéaste classique, consiste dans ce souci du dÈpouillement que permet l’accomplissement de passions élémentaires (la justice en ses divers contours) dans un cadre naturel exceptionnel. Ainsi, L’appât est, sans nul doute, le plus nu des westerns de Mann-Stewart. En ne présentant aucun lieu clos autre que ceux que la nature peut fournir (grotte, torrent), le cinéaste se tient aux confins d’une civilisation dont nous ne voyons jamais les formes. Cette prédominance de l’ouverture sur une sauvagerie non domestiquée qui aide au récit à advenir donne à cette œuvre une dimension authentiquement élémentaire.
Conçu comme spécifique de par ses options radicales d’austérité, L’appât est produit par la Metro Goldwyn Mayer et demeure le seul western avec Stewart financé par la Major (le reste se partageant entre Universal et Columbia). Fondé depuis 1924, le premier des Studios américains, se caractérise par l’ambition artistique qu’exprime sa devise, “ Ars gratia artis ”. Elle se décline en autant de stars (Valentino, Garbo, Gable, Stewart) que de prouesses techniques, dont l’emploi du Technicolor féerique dans Le Magicien d’Oz de Victor Fleming, 1938, est un éloquent exemple. De fait, les rares westerns de son catalogue s’inscrivent dans une perspective historique et/ou littéraire dite de prestige, comme en témoignent des titres tels que Le grand passage de King Vidor, 1940, ou Convoi de femmes de Willam Wellmann, 1951. Cela se vérifie pour Mann dont le seul autre western produit par la Metro (La porte du diable) est un grand film à thèse, vigoureux plaidoyer pro-Amérindien. Le dépouillement allégorique de L’appât, la richesse de ses personnages, éloignés des archétypes manichéens, son respect (lointain mais présent) des trois unités du théâtre classique le prédisposent à être plus qu’un simple produit de série.
Cette singularité se retrouve aussi dans le choix des deux scénaristes, Harold Jack Bloom et Sam Rolfe, après que Borden Chase ait signé les deux précédents opus. Leur signature (seule collaboration avec Mann) peut rétroactivement être étoffée par la remarque que c’est dans la sérialité (surtout télévisée) que les deux hommes, séparément, ont souvent œuvré : création, avec Norman Felton, de la série Des agents très spéciaux, écriture des saisons de Star Trek pour Rolfe; travail sur des épisodes (Au cœur du temps, Urgences,Bonanza), et sur On ne meurt que deux fois (un des derniers James Bond-Sean Connery, 1967) pour Bloom. Le scénario de L’appât travaille sur un fondement préalable – la figure de Stewart -, des récurrences thématiques et une structure à péripéties (de l’arrestation de Ben à ses tentatives d’évasion) qui s’apparentent à un feuilleton, l’argument policier de base (il s’agit d’arrêter un homme) ainsi que son développement complexe (trahisons et alliances de ceux qui doivent le faire) pouvant annoncer la “ greffe ” d’autres genres sur le western (dont le thriller, voire le film noir) qui précise le travail futur des deux hommes. Ces deux remarques précisent combien cette œuvre, inscrite dans une série, elle-même insérée dans un genre, a été conçue comme singulière
Outils
Bibliographie
L’appât, Philippe Ortoli, dossier pédagogique “Lycéens au cinéma”, CNC/APCVL, 2003.
Le western. Approches-mythologies-auteurs-acteurs-filmographies, Raymond Bellour (sous la direction de), "10/18", 1969
Un recueil aux contributions très brillantes (Bory, Tavernier, Tailleur, et même Glucksman) de perspectives critiques sur le genre assorti d’un dictionnaire thématique et artistique.
Les genres du cinéma, Raphaëlle Moine, collection “Nathan Cinéma”, 2002.
La meilleure synthèse actuelle sur la question du genre au cinéma, de ses approches, de son histoire.